L'adrénaline.
Concours Ecole de Santé des Armées 2015.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts.
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercice 1.
Posologie de l'adrénaline AGUETTANT 1 mg/mL.
Pour le traitement de l'arrêt cardiaque :
administration intraveineuse de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes jusqu'à
rétablissement de la circulation sanguine.
Pour le traitement d'un choc allergique ( 2possibilités) :
1) Dilution de l'ampoule de 1 mL dans 10 mL de sérum physiologique puis
administration en intraveineuse de 1 mL de solution diluée.
2) Administration par voie sous-cutanée de 0,3 mL de l'ampoule.
16. A propos de
l'injection d'adrénaline AGUETTANT 1 mg / mL :
A. Pour traiter un patient en arrêt cardiaque il est nécessaire
d'injecter deux ampoules toutes les 3 à 5 minutes en intraveineuse.
Faux.
B. Pour traitr un choc allergique en intraveineuse, il faut administrer
1 mg d'adrénaline. Faux, 0,1 mg C.
Pour traiter un choc allergique par voie sous cutanée, on injecte 0,3
mg d'adrénaline. Vrai.
D. L'adrénaline est
une molécule qui peut être synthétisée par voie chimique. Vrai.
E. Il y a un risque de surdosage si un médecin traite un arrêt
cardiaque avec les doses recommandées pour un choc allergique. Faux.
Exercice 2. Etude structurale de
l'adrénaline.
Il existe deux stéréoisomères de configuration de l'adrénaline :
La L-adrénaline et la D-adrénaline. Dans un premier temps on
s'intéresse à la L-adrénaline.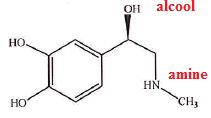
17. Parmi les
groupes caractéristiques suivants, lequel ( lesquels) caractérise(nt)
la molécule d'adrénaline ?
A. Alcool ( vrai) ; B. Cétone ; C. acide
carboxylique ; D. Amine ( vrai) ; E. Amide.
18.
Parmi les propositions ci-dessous, indiquez laquelle ( lesquelles)
peut( vent) correspondre à la D-adrénaline, énantiomère de la L-
adrénaline.
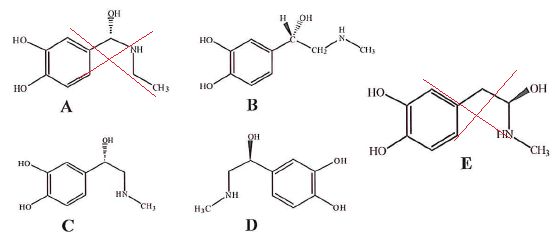
19. Parmi les propositions
suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. La L-adrénaline comporte deux atomes de carbone asymétriques. Faux.
B. La L-adrénaline
est une molécule chirale. Vrai.
C. La D-adrénaline possède une formule semi-développée différente de la
L-adrénaline. Faux.
D. La D-adrénaline est une molécule achirale. Faux.
E. Aucune réponse juste. Faux.
Exercice
3. Etude de la synthèse de l'adrénaline.
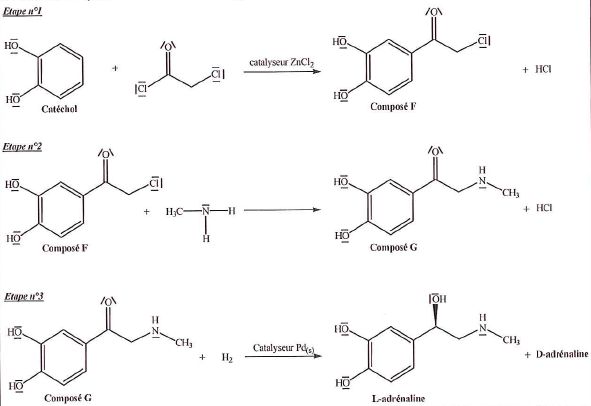
1.
Pour chacune des trois étapes, préciser si la réaction résulte d'une
modification de chaine ou d'une modification de groupe caractéristique.
Etapes 1 et 2 :
modification de chaîne.
Etapes 2 et 3 : modification de groupe caractéristique.
2. A quelle
catégorie de réaction appartient l'étape 2 ?
Substitution de Cl par NH-CH3.
3.
Etape 2 : identifier le site donneur et le site accepteur
d'électrons et ajouter un minimum de flèches courbes.
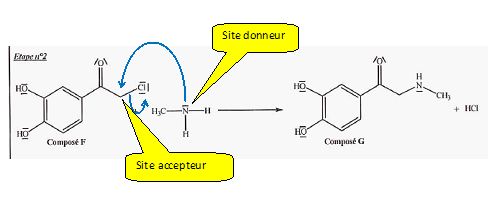
4. A l'issue de
cette synthèse on obtient un mélange racémique des deux énantiomères de
l'adrénaline. Quelle est la composition d'un tel mémange ?
50 % de L-adrénaline et 50 % de D-adrénaline.
5. Quel est le rôle
du catalyseur ZnCl2 dans l'étape 1 ?.
Formation de l'intermédiaire  ; ce dernier réalise une
substitution électrophile sur le cycle benzénique. ; ce dernier réalise une
substitution électrophile sur le cycle benzénique.
6. La catalyse de
l'étape 3 est-elle homogène, hétérogène ou enzymatique ? Justifier.
Le catalyseur est solide, l'un des réactif H2 est un gaz :
la catalyse est hétérogène.
7. Si l'étape 3
avait été catalysée par une enzyme, quelle aurait été la différence
fondamentale concernant le produit de la réaction ?
On aurait obtenu un seul énantiomère et non pas un racémique.
|
| .
. |
|
|
Exercice 4. Séparation
des énantiomères de l'adrénaline.
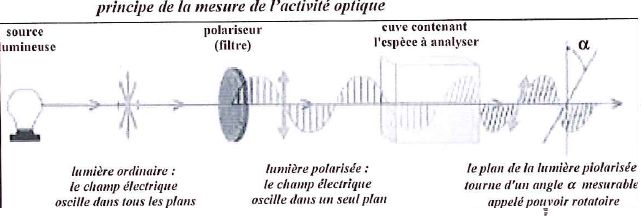
Une
onde lumineuse est représentée par un champ électrique qui oscille dans
un plan orthogonal au rayon lumineux ; pour la lumière naturelle, la
direction de l'oscillation du champ électrique est aléatoire. A la
traversée du polarisuer, seule une direction d'oscillation est
conservée : l'onde est polarisée.
Si on place une solution contenant une espèce chimique chirale sur le
trajet d'un faisceau de lumière polarisée, alors la lumière et l'espèce
interagissent, ce qui provoque la rotation du plan de la lumière
polarisée d'un certain angle a
mesurable appelé pouvoir rotatoire ou activité optique.
Si du point de vue de l'observateur, le plan de polarisation de la
lumière tourne vers la gauche, l'activité optique sera négative et la
substance analysée sera dite lévogyre.
Si
du point de vue de l'observateur, le plan de polarisation de la lumière
tourne vers la droite, l'activité optique sera positive et la substance
analysée sera dite dextrogyre.
Séparation des énantiomères de l'adrénaline.
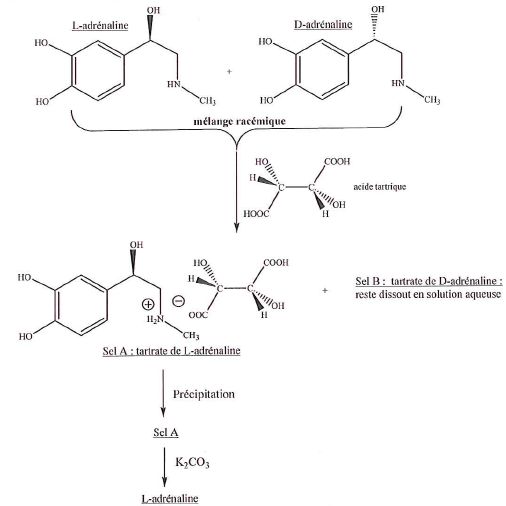
20.
On considère un mélange de L-adrénaline et de D-adrénaline. Identifier
la ( les) proposition(s) vraie(s) parmi les propositions suivantes.
A. La L-adrénaline ( a = +53,3° ) est lévogyre.
Faux.
B. Un mélange 50/50
des deux énantiomères de l'adrénaline ne dévie pas le plan de
polarisation d'une lumière polarisée. Vrai.
(D-adrénaline ( a = -53,3° ).
C. Les deux énantiomères peuvent être séparés par cristallisation.
Faux.( ils ont la même solubilité dans l'eau ).
D. Les deux énantiomères peuvent être séparés par solubilisation
sélective dans l'eau à 25°C. Faux.
E. Les deux énantiomères de l'adrénaline ont des propriétés chimiques
identiques vis à vis des molécules chirales. Faux.
21. On s'intéresse à la réaction de
l'adrénaline avec l'acide tartrique. Identifier la ( les) proposition(s)
vraie(s) parmi les propositions suivantes.
A. L'acide tartrique utilisé
est une molécule achirale. Faux.
B. L'adrénaline réagit en tant qu'acide au sens de Brönsted. Faux, en
tant que base.
C. Les sels A et B
sont diastéréoisomères. Vrai.
D. Les sels A et B
ont des propriétés physiques différentes. Vrai.
E. La réaction permettant de transformer le sel A en L-adrénaline est
une réaction d'oxydo-réduction. Faux.( réaction acide base).
|
Le
propanolol comporte trois groupements caractéristiques semblable à
l'adrénaline
25. Identifier
la ( les) proposition(s) vraie(s) parmi les propositions suivantes.
A.
L'écriture de la constante d'acidité du couple HA(+ -) / H2A(+)
est :
Ka1 = [H3O+][H2A(+)] /
[HA(+ -)] Faux. Ka1
= [H3O+] [HA(+ -)] / [H2A(+)].
B. A(-) est
l'espèce basique du couple de constante d'cidité Ka2. Vrai.
C. Dans le couple
de constante d'acidité ka1, c'est la fonction acide carboxylique qui
cède son proton.
Vrai.
D. L'équation bilan associée à la constante Ka1 est :
H2A(+)
liq + H2O liq = HA(+
-) liq + HO-liq. Faux.
H2A(+)
liq + H2O liq = HA(+
-) liq +H3O+liq.
E. L'équation
bilan associée à la constante Ka1 est :
H2A(+)
liq + H2O liq = A(-)
liq +H3O+liq.
Faux.
26. On donne ci-dessous le diagramme
de prédominance ( incomplet) de la phénylalanine. Les lettres a, b, c
et d correspondent à des grandeurs ou espèces qu'i faut identifier.
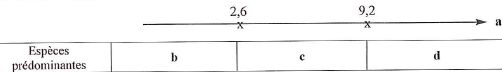
A. b = A(-). Faux . b = H2A(+)
B. a = pKa. Faux. a = pH.
C. L'espèce c est
globalement neutre. Vrai.
D. Lors d'une électrophorèse avec un tampon pH = 5,9, la phénylalanine
migre vers la cathode. Faux.
La phénylalanine est sous la forme A(+ -), elle ne migre pas.
E. Aucune réponse juste. Faux.
|
|