Le principe des
barrages appliqué en mer, le jus de tofu devient de l'électricité, la
voiture électrique, le vélo électrique, se chauffer grâce au numérique,
bac L, ES 2017.
En
poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation
de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres
d’intérêts.
|
|
|
|
|
Une
batterie bleue pour de l’énergie verte
Bordé
par la mer Baltique et la mer du Nord, le Danemark est un pays
constitué d’une péninsule et de 443 îles, dont le point le plus haut
est situé à seulement 173 m d’altitude. L’une de ses particularités
est son important littoral de 7 314 km, aux côtes plates et aux fonds
marins assez superficiels (peu profonds).
Le
Danemark est compté parmi les leaders mondiaux en matière d’éolien,
en produisant déjà une part de 20 % de son électricité à partir
d’installations terrestres et offshore. Le pays prévoit d’augmenter
cette part de 20 % à 30 % d’ici 2020. Afin de lisser les fluctuations
de production et de consommation, le Danemark continue pour l’instant
de solliciter ses centrales thermiques à combustibles fossiles, sur
lesquelles reposent encore une part de 44 % de la production
électrique du pays.
Le principe des barrages appliqué en mer.
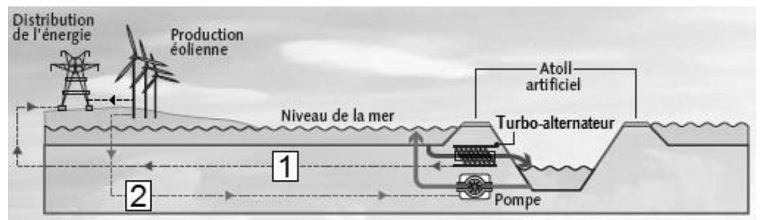
--->
Réseaux électriques, les flèches indiquent le sens des déplacements.
--> Sens des
déplacements d'eau.
1 : fonctionnement en période de forte demande
en électricité et de faible production des éoliennes. L'eau de mer
remplit l'atoll en passant par les turbines.
2. Fonctionnement en période de faible demande
en électricité et de forte production des éoliennes. Des pompes
électriques vident le réservoir de l'atoll.
D'après les Echos le 24 / 09 / 2009.
Question 1 :
Donner deux raisons encourageant le Danemark, comme de nombreux autres
pays, à abandonner progressivement l’usage des énergies fossiles.
Les réserves en énergies fossiles sont limitées ; ces énergies vont
s'épuiser.
La combustion des énergies fossiles libère du dioxyde de carbone, gaz à
effet de serre.
Question 2 :
Citer le principal problème auquel le Danemark se heurte en augmentant
sa dépendance au vent comme source d’énergie. Expliquer brièvement
la réponse.
Le vent est une énergie renouvelable, mais intermittente. Lors
d'une forte demande en électricité, il n'y a pas forcément suffisamment
de vent.
Lors d'une faible demande en électricité, il peut y avoir beaucoup de
vent. Or on ne sait pas encore stocker de manière peu onéreuse l'excès
d'électricité.
Question 3 :
Sans recopier les chaînes énergétiques ci-dessous et à partir du
document 1, indiquer la forme d’énergie à faire apparaître dans
chaque cadre numéroté de 1 à 4.
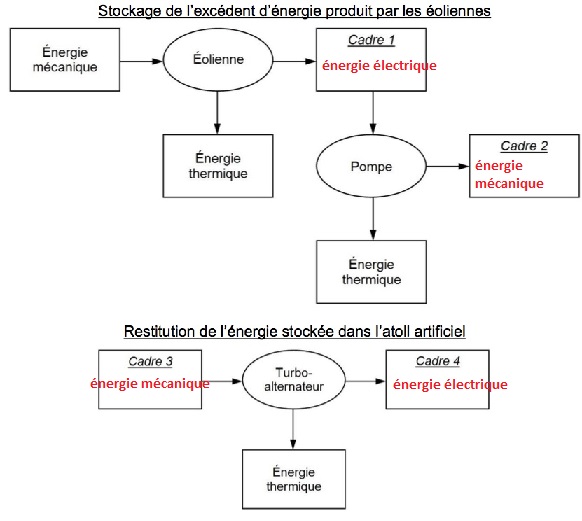
Question
4 :
4.1. Expliquer pourquoi le projet
d'atoll en pleine mer répond au contexte du Danemark tant du point de
vue énergétique évoqué à la question 2, que du point de vue
géographique.
Ce projet permet de stocker l'excès d'électricité ( en présence de
vent important et de faible demande ) et de la restituer lors
d'une demande importante en électricité et de vent faible.
L'intermittence du vent est un problème résolu.
Ce pays possède un vaste domaine maritime et une mer peu profonde.
4.2. Donner deux arguments montrant
que le projet « Green Power Island » s’inscrit bien dans une démarche
de développement durable.
Le
réservoir de l'atoll est utilisé pour cultiver des algues,
dont le rôle est à la fois d’absorber du dioxyde de carbone CO2 lors
de leur croissance et de servir de matière première pour la
fabrication de biocarburants.
Ce projet utilise les énergies renouvelables ( eau, vent, soleil,
biomasse).
Il limite le recours aux énergies thermiques en cas de vent faibleet
contribue à la diminution de l'émission de CO 2 dans
l'atmosphère.
Question
5 :
Dans
l’hypothèse où l’atoll énergétique prévu au large de Copenhague
permettrait d’alimenter en électricité toutes les installations
domestiques de la ville pendant une durée de 24 heures en l’absence
totale de vent, calculer la puissance moyenne équivalente électrique
de son réservoir d’eau.
Ce projet permet de régénérer une
énergie électrique totale de 2,4 GWh.
Puissance ( W) = énergie ( Wh) / temps (heure) = 2,4 109 /
24 =1,0 108 W ou 0,1 GW.
|
|
|
|
Le
jus de tofu devient de l'électricité.
À
Kalisari, en Indonésie (Asie), on fabrique depuis des siècles du tofu
qui est un fromage à base de lait de soja. On fait cailler le lait par
ajout d’acide acétique (ou de vinaigre), puis on presse la pâte ainsi
obtenue afin d’en extraire l’excédent de liquide. Cela correspond à une
extraction de 33 litres de liquide par kilogramme de tofu.
Des
milliers de litres de ce liquide étaient auparavant déversés dans les
rivières de la région, souillant les cours d’eau et contaminant les
rizières en aval. Ce liquide contient des matières organiques et
constitue une partie importante des déchets évacués par des petites
entreprises.
À
présent, pas moins d’une centaine de petites entreprises évacuent leurs
déchets grâce à un traitement dans des cuves où une transformation
chimique se produit pour permettre la fabrication de biogaz.
La cogénération est la production
simultanée d’énergie électrique et d’énergie thermique (chaleur) à
partir d’un combustible, ici le biogaz, dans un dispositif unique
appelé cogénérateur et constitué d’un moteur et d’un alternateur.
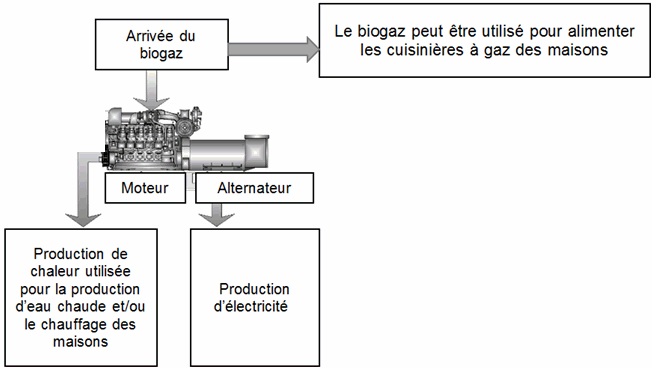
Question
1 :
Pendant
longtemps, les producteurs de tofu étaient dépendants des livraisons
sporadiques des bouteilles de gaz naturel servant à alimenter leurs
fours. À présent ils peuvent se procurer du biogaz à tout moment.
Expliquer
pourquoi le biogaz peut être qualifié de ressource énergétique
renouvelable.
Tant
qu'il y aura du lait de soja ( est à dire du soleil et de l'eau ), on
fabriquera du fromage et un sous-produit le jus de tofu.
Cette énergie ne s'épuise pas elle est sans cesse renouvelée.
Question
2 :
À
Kalisari, grâce au seul usage du biogaz, les petits producteurs de tofu
bénéficient d’électricité dans leur maison.
Préciser
sans calcul si cette solution écologique serait suffisante à l’échelle
de l’Indonésie, sachant que ce pays comporte des milliers de petits
producteurs de tofu et plus de 60 millions de familles.
Non,
des milliers de petits producteurs ne peuvent pas contribuer à fournir
de l'électricité à des millions de foyers. Par contre cela permet
d'avoir de l'électricité dans des endroits isolés.
Question
3 :
Recopier
le numéro de la bonne proposition de chaîne énergétique de l’ensemble
constitué par le moteur et l’alternateur, sur la copie :
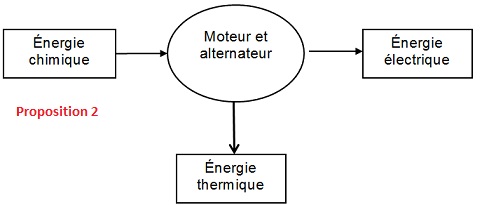
Question
4 :
En
Indonésie, la production d’électricité se fait essentiellement grâce
aux centrales thermiques à flamme utilisant du charbon. Une centrale de
ce type peut délivrer une énergie électrique égale à environ 9,0×10 9
kWh pendant une année (soit environ 9 000 h).
4.1. Calculer l’énergie produite par
un cogénérateur de puissance P égale à 100 kW pendant une année (soit
environ 9 000 h).
Energie ( kWh) = puissance ( kW) x temps (heure) =
100 x9000 =9,0 105 kWh.
4.2. En déduire combien il faudrait
de cogénérateurs de même puissance électrique égale à 100 kW pour
assurer une production d’énergie électrique identique à celle d’une
centrale thermique à flamme pendant une année (soit environ 9 000 h).
9,0
109 /(9,0 105)= 10 000.
Question
5 :
Donner deux arguments montrant l’intérêt
environnemental d’un dispositif méthanisation-cogénération à Kalisari.
On évite la contamination
des rizieres en aval.
Production d'énergie thermique et électrique à partir d'énergie
renouvelable, donc sans émission de gaz à effet de serre.
|
|
|
|
La
voiture électrique.
D'après
les journaux spécialisés, le moteur électrique d'une voiture hybride
est très silencieux, particulièrement au démarrage. En conduite
urbaine et à faible vitesse, seul fonctionne le moteur électrique
grâce à des batteries au lithium. En
fonctionnement mixte, électrique et thermique, la puissance du moteur
électrique s’ajoute à la puissance délivrée par le moteur à
explosion. La contribution en énergie de chacun des moteurs est
régulée automatiquement. Une
voiture hybride peut passer de 0 à 100 km/h(*) en moins de 11
secondes. Pendant les phases de freinage, l’énergie cinétique du
véhicule est utilisée pour recharger les batteries. Source : ADEME, agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie
Question
1
Identifier
la(les) forme(s) d’énergie utilisée(s) par une voiture hybride.
Energie électrique fournie par les batteries.
Energie thermique fournie par la combustion du carburant.
Energie cinétique lors du freinage pour la recharge des batterie.
Question
2
2.1 - À partir du diagramme
suivant, nommer les formes d’énergie 1 et 2 mises en jeu par le moteur
électrique pendant une phase de freinage.
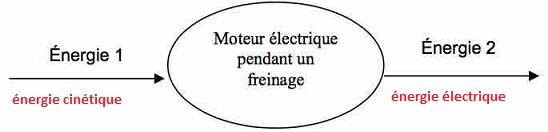
Question
3
3.1 - Donner deux arguments qu'un
vendeur automobile peut avancer en faveur d’un véhicule
électrique.
Pas d'émission de CO2, gaz à effet de serre.
Voiture assez silencieuse.
3.2 - Expliquer en quoi la
contribution à l’effet de serre d’une voiture électrique n’est pas
négligeable.
L'électricité, utilisée pour la recharge des batteries, est en partie
produite par des centrales thermiques.
Question
4
Dans
le document 3 est mentionnée l’unité kWh.
4.1 - Donner la signification du
symbole kWh.
4.2 - Indiquer la grandeur physique
exprimée dans cette unité.
L'énergie peut s'exprimer en kilo
wattheure.
Question
5
Une
voiture électrique en France consomme 10 kWh pour parcourir 100 km.
Déterminer l'impact carbone par km parcouru.
En France, impact carbone par kWh produit : 83 g de CO2.
Soit 830 g pour 10 kWh consommé pour parcourir 100 km ou 8,9 g par km.
Le vélo électrique.
Un habitant d’une grande ville se rend en vélo à son bureau. Il
effectue cinq allers-retours par semaine. Le trajet aller est de 5
kilomètres, qu’il parcourt en 20 minutes. Il apprécie d’emprunter les
pistes cyclables : le trajet est plus court, il s’y sent davantage en
sécurité, un peu à l’écart de la circulation automobile.
Question
1 :
Expliquer
le mot « assistance » dans l’expression « vélo à assistance électrique
».
Le
moteur électrique génère une certaine puissance mécanique aidant,
facilitant le pédalage.
Question 2 :
Préciser,
en justifiant, si les vélos A, B et C du document 3 sont des vélos à
assistance électrique ou des vélos électriques.
La
puissance du moteur électrique des vélos A et B est de 250 W ; la
capacité de la batterie est de 300 Wh. Ce sont des vélos à assistance
électrique.
La
puissance du moteur électrique du vélo C est de 600 W ; la
capacité de la batterie est de 500 Wh. C'est un vélo électrique.
Question 3 :
Les
arguments de vente. Indiquer si l’argument 1 est correct. Justifier.
Indiquer si l’argument 2 est correct. Justifier.
Argument 1 : « Vous mettrez deux fois moins de temps
pour vous rendre au travail.
Vitesse
moyenne de déplacement en ville selon le mode de transport :
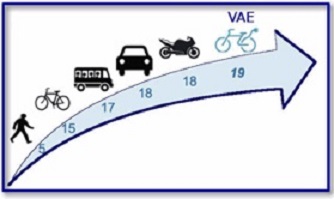
Cet argument est faux ; les viteses moyennes du bus, de la voiture, de
la moto et du VAE sont presque les mêmes.
–
Argument 2 : « Vous aurez besoin de le recharger une fois par semaine
seulement.
Distance parcourue en une semaine : (5 + 5) x2 = 50 km.
L'argument est vrai seulement pour le vélo A, faux pour les deux autres.
Question 4 :
Déterminer,
pour le vélo A, dans le cas d’une assistance électrique maximale,
compte tenu de la capacité de la batterie, la durée de l’assistance.
Capacité de la batterie 300 Wh ; puissance du moteur : 250 W.
Durée de l'assistance : 300 / 250 =1,2 h ou 1 h 12 min.
Question 5 :
Identifier
les formes d’énergie figurant dans le diagramme énergétique ci-dessous,
relatif au vélo électrique lorsque l’assistance est enclenchée :
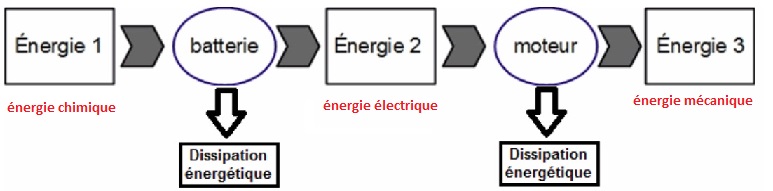
|
|
Se chauffer grâce au numérique ?
Document 1 : coût
énergétique des courriels
En une heure, dix milliards de courriels sont expédiés aujourd’hui.
La
consommation d’énergie électrique induite équivaut à la production de
15 centrales nucléaires, pendant une heure, soit environ 4000 tep
(tonne équivalent pétrole*).
En effet, d’après Coline Tison, il faut
fournir une énergie de 5 Wh pour envoyer un courriel simple et de 24 Wh
pour un envoi avec une pièce jointe de 1 Mo.
Ce n’est pas le transport de l’information, sur des dizaines de
milliers de kilomètres, qui consomme le plus. De très loin, c’est le
stockage dans les centres de données (data centers), dans les serveurs
et les disques durs, ainsi que les sauvegardes sur d’autres machines.
* La tonne équivalent pétrole (tep) est l’énergie produite par la
combustion d’une tonne de pétrole. 1 tep représente environ 11,6 MWh. D’après http://www.futura-sciences.com/.
Question
1 :
Définir
le caractère renouvelable d’une ressource d’énergie. Citer deux
ressources d’énergie renouvelable et une ressource d’énergie non
renouvelable.
L'énergie
solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éoliennesont des énergies
renouvelables. Elles sont inépuisables et se renouvellent naturellement
est rapidement.
Le pétrole, le charbon sont des énergies fossiles qui s'épuisent.
Question
2 :
Calculer
la puissance moyenne fournie par une centrale nucléaire d’après les
informations fournies.
4000
x 11,6 MWh consommés à chaque heure.
Puissance
moyenne d'une centrale nucléaire : 4000 x11,6 / 15 ~3100 MW.
Question 3 :
Identifier les solutions envisagées pour limiter l’impact écologique de
l’utilisation des serveurs informatiques.
data centers alimentés par l’énergie éolienne,
solaire ou hydraulique.
L’énergie
thermique dégagée par l’activité intensive des processeurs est
transmise à des dissipateurs puis restituée pour chauffer une pièce.
Question 4 :
Reproduire puis compléter la chaîne énergétique suivante correspondant
au fonctionnement simplifié d’une centrale nucléaire en identifiant la
forme d’énergie dans chaque rectangle :
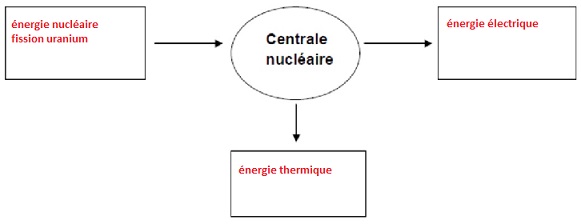
|
|