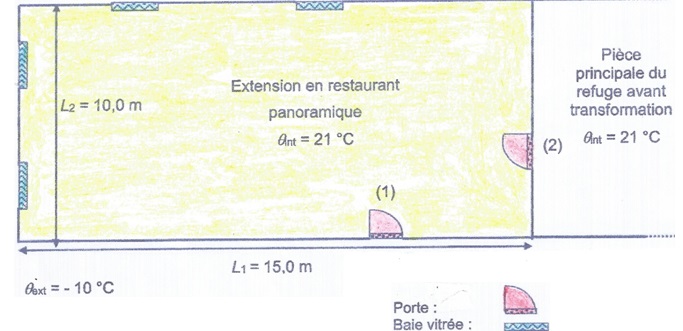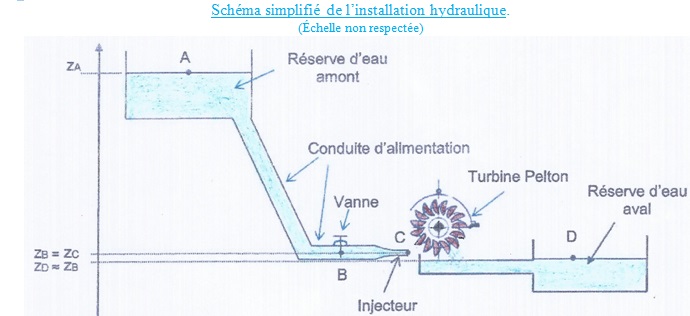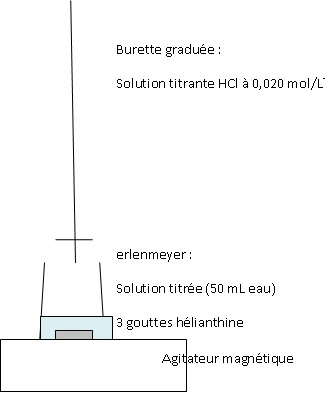Transformation
d'un refuge,
Bts Bâtiment 2019.
En
poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation
de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres
d’intérêts.
|
|
......
.....
|
Les propriétaires
d’un refuge désirent l’agrandir en restaurant
panoramique utilisable en saison hivernale.
Le refuge n’étant
pas relié au
réseau électrique et disposant déjà d’un parc de panneaux solaires,
l’installation d’une pico-centrale hydroélectrique est donc envisagée.
Thermique (A)
Étude
thermique du restaurant.
Le refuge de
montagne est situé à 2350 m
d’altitude.
Description de l’extension.
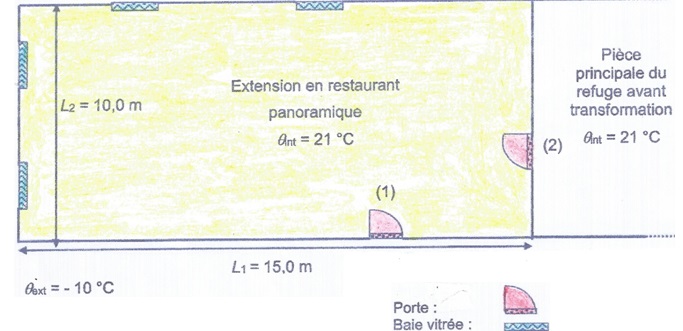
1- Résistances
thermiques surfaciques des parois.
1) Exprimer littéralement la
résistance
thermique surfacique rp de la porte reliée à l’extérieur. Calculer sa valeur.
Epaisseur ep = 8,0 cm ; largeur 0,95 m ; hauteur : 2,00 m ; lp =0,20 W m-1
K-1.
rp =rsi +rse+ ep / lp =0,11 +0,060
+0,080 / 0,20 =0,57 m2 K W-1.
2) Exprimer littéralement la
résistance
thermique surfacique rm d’un mur. Calculer
sa valeur.
Composition d'un mur multicouche :
Béton eb = 20 cm, lb=
1,4 ; laine de verre : eL
= 20 cm, lL= 0,04 ;
plâtre :epl = 1,3 cm, lpl= 0,40.
rm = rsi +rse+ eb / lb +eL / lL +epl / lpl = 0,11
+0,060 +0,20 / 1,4 +0,20 /0,04 +0,013 /0,4= 0,14286 +5,0 +0,0325 =5,175
~5,2 m2 K W-1.
rm= 0,17
+0,14286 +5,0 +0,0325 =5,345 ~5,3 m2 K W-1.
2- Transferts
thermiques à travers les portes et les murs.
Pour la suite du problème, on prendra : rp =0,57 m2 K W-1
; rm =5,3 m2 K W-1.
1) Que peut-on dire du flux
thermique pour la
paroi séparant le refuge et le restaurant ? Justifier.
Les deux locaux étant à la même température, le flux thermique pour la
paroi séparant le refuge et le restaurant est nul.
2. Exprimer
littéralement les flux thermiques Fp à travers la
porte et Fm
à travers l'ensemble des murs. Les calculer.
Fp
=Sp (qint-qext) / rp
=0,95 x2,00 (21-(-10)) / 0,57 =103,33 ~103 W.
Fm
=Sm (qint-qext) / rm
;
surface des murs : (15 +10 +15 ) x2,50 - 0,95 x2 - 4 x1,80
x 2,15 =100-1,9 -15,48 =82,62 m2.
Fm =82,62 x31 /
5,3 =483 W.
3- Pertes
thermiques par la ventilation.
Pour renouveler
l’air et éviter les problèmes
de condensation, une ventilation est installée dans le restaurant.
Elle prélève l’air
extérieur à la température θext
= -10°C pour l’injecter à l’intérieur du restaurant.
Chaque heure, 15%
du volume d’air du
restaurant est renouvelé.
capacité thermique de l’air : cair
= 1,22.103 J.m-3.K-1
1) Montrer que l’énergie Q nécessaire pour
réchauffer cet air vaut
2,1.106 J par heure de fonctionnement.
Volume du restaurant : 15
x 10 x 2,50 =375 m3.
Volume d'air renouvellé
par heure : V =375 x0,15 =56,25 m3.
Q = V Cair
Dq=56,25 x 1,22 103
x31 ~2,1 106 J.
2) Calculer la puissance thermique Φven
associée à ce
chauffage.
2,1 106
/ 3600=591 W.
4- Bilan
thermique du restaurant.
Les flux thermiques perdus par
le sol,
le plafond et les baies vitrées du restaurant
s’élèvent au total à 340 W.
Montrer que la puissance
thermique Pth
que devra apporter le système de chauffage pour maintenir la
température à
l’intérieur du restaurant est de 1,5 kW.
103 + 483 +591 +340 =1517 W ~1,5 kW.
|
|
Mécanique des
fluides.
Une pico-centrale
est une installation transformant l’énergie hydraulique d’un cours
d’eau en
énergie électrique, d’une puissance inférieure à 20 kW.
La puissance de la
centrale est directement
proportionnelle à son débit d’équipement et à sa hauteur de chute.
Une turbine reliée
à un alternateur (non représenté) est alimentée par une retenue d’eau.
Les conduites sont
enterrées dans le sol pour
éviter le gel.
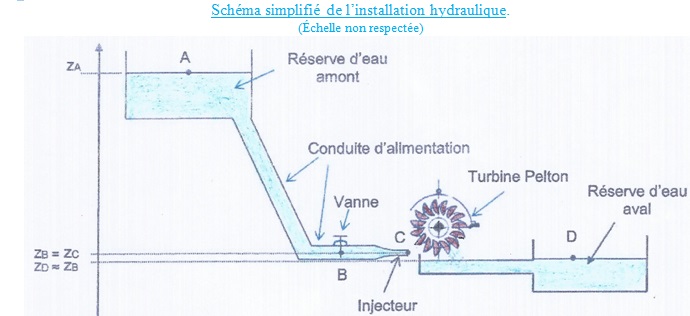
1- La vanne est fermée.
1) Exprimer littéralement puis
calculer la pression
relative Pr (B)
exercée sur la paroi gauche de la vanne.
Pr(B) = reau g (zA-zB)
= 1000 x 9,8 (2368-2353)=1,47 105 Pa ~1,5 bar.
2) En déduire la valeur de la force
F (B)
exercée par l’eau sur le clapet de la vanne sachant que sa surface
plane est s
= 0,25 cm2.
FB =Pr(B)
s = 1,47 105 x0,25 10-4 ~3,7 N.
2- La vanne est ouverte.
L’eau circule dans
l’installation et sort de
l’injecteur vers la turbine Pelton qui se met en rotation.
Au bout de quelques secondes,
on suppose que
le régime permanent est atteint.
L’eau est considérée comme
fluide parfait
incompressible et on suppose que les niveaux de l’eau dans les retenues
amont
et aval restent constants.
Vitesses de
l’eau et débit
1) En appliquant l’équation de
Bernoulli
entre deux points à préciser, montrer que la vitesse d’écoulement vc
du fluide au point C (sortie
de l’injecteur) vaut 17 m.s-1.
Entre les points A et C : vA = 0 ; PA = PC
= Patm ; zA-zB =15 m.
Equation de Bernoulli : 0,5 r (
vA2-vC2) +rg(zA-zC)+PA-PC=0.
0,5 x1000(-vC2)+1000
x9,8 x15 =0 ; vC2=9,8 x15 / 0,5 =294 ; vC =17,14 ~17 m
/s.
2) Exprimer
littéralement puis calculer, en m3.s-1, le débit
volumique qv de l’eau dans la conduite
d’alimentation.
Diamètre de la conduite : 0,10 m. Section :S = 3,14 x0,102
/ 4 = 0,00785 m2.
Diamètre de la sortie de l'injecteur : 0,04 m ; section S' = 3,14 x0,042
/ 4 = 1,257 10-3 m2.
Conservation du débit qv = vC S' =17,14 x1,257 10-3 =
0,02154 ~0,022 m3 s-1.
3) Exprimer
littéralement puis calculer la vitesse vB de l’eau dans
la conduite d’alimentation.
Conservation du débit qv = vB
S ; vB = 0,02154 / 0,00785 = 2,744 ~2,7 m /s.
Puissance
de
la pico-centrale
La puissance maximale Pext
récupérable est égale à 3,0 kW.
Le rendement de la
turbine est η = 60%.
4) Calculer la puissance électrique Pélec
produite par l’alternateur, supposé sans perte.
Pélec
= Pext x rendement =3,0 x 0,60 =1,8 kW.
5) La pico-centrale permettra-t-elle un
apport de puissance suffisant pour le refuge après
transformation ? Justifier.
Oui : la puissance
électrique de la picocentrale est supérieure à la puissance thermique
du système de chauffage.
|
...
|
|
.
|
....
|
Solutions
aqueuses (C)
Analyse de
l’eau du circuit hydraulique.
L’eau circulant dans la
pico-centrale doit
être contrôlée pour assurer le bon fonctionnement de
l’installation : une
eau trop « dure » favorise l’entartrage des canalisations et
de
l’injecteur, alors qu’une eau trop « douce » favorise la
corrosion de
la turbine en acier ; de même, une eau trop alcaline ou trop
basique est
« agressive » vis-à-vis des canalisations et favorise
également le dépôt
de tartre.
1- Nature
acido-basique de cette eau.
Un laboratoire a mesuré une
concentration
molaire volumique en ions oxonium dans cette eau égale à 1,6.10-6
mol.L-1.
1) Calculer
le pH de cette eau.
pH = -log(1,6 10-6) =5,8.
2)
Préciser la nature acido-basique de cette eau, en justifiant.
Le pH de l'eau étant inférieur à 7, l'eau est acide.
2- Mesure
du TAC (titre alcalimétrique
complet).
Le TAC est égal au volume (mL)
d’acide chlorhydrique à 0,020 mol.L-1 nécessaire pour doser
100 mL d’eau en présence d’un indicateur coloré, l’hélianthine.( zone
de virage [ 2,4 ; 4,4 ].
Il s’exprime en degrés français
et ses valeurs optimales sont comprises entre 10°f et 25°f.
En pratique, pour déterminer le
TAC, on
prélève 50 mL d’eau auquel on rajoute 3 gouttes d’hélianthine.
Le dosage est réalisé sous
agitation
magnétique en rajoutant progressivement de l’acide chlorhydrique à
0,020 mol.L-1,
jusqu’au volume équivalent.
1) Faire un
schéma en coupe et annoté du dispositif expérimental de
dosage.
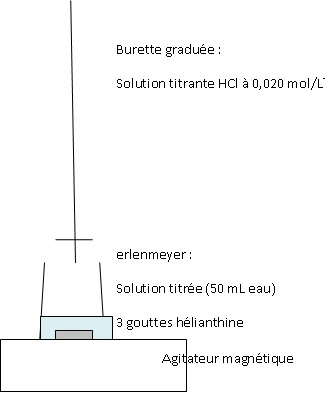
2) Quelle est la couleur de l’indicateur coloré au début du
dosage ? Justifier
Le pH de l'eau est voisin de 5,8, valeur supérieuire à 4,4 ;
l'hélianthine est jaune.
3) Comment voit-on que l’équivalence est atteinte ?
Changement de couleur de la solution : jaune ---> rouge.
Pour l’eau alimentant la
pico-centrale, on
trouve VE = 7,1 mL.
4) En
déduire son TAC et conclure.
TAC = 2 x7,1 = 14,2°f, valeur comprise entre 10 et 25°f.
Dureté de l'eau.
L’eau alimentant la
pico-centrale possède une
concentration massique volumique de 55 mg.L-1 en ions
calcium et 13
mg.L-1 en ions magnésium.
Calculer le titre
hydrotimétrique TH de cette
eau et conclure.
TH =10 ([Mg2+] + (Ca2+] ), les concentrations
étant exprimées en mmol / L.
[Ca2+]= 55 / 40 ~1,375 mmol /L ; [Mg2+]= 13 / 24
~0,542 mmol /L ;TH = 10 (1,375 +0,542) ~19°f, valeur comprise entre 15
et 40 : l'eau est moyennement dure.
|
|