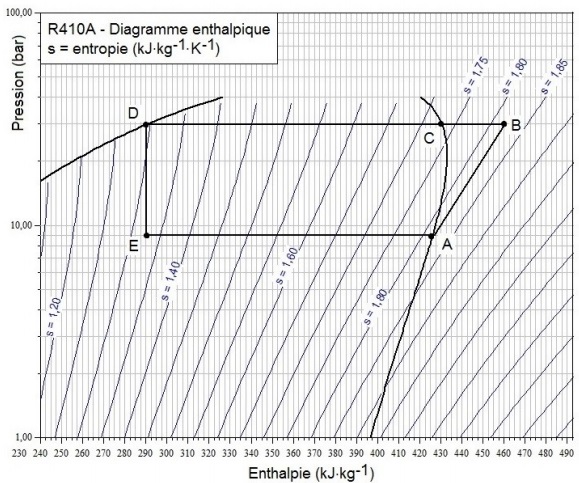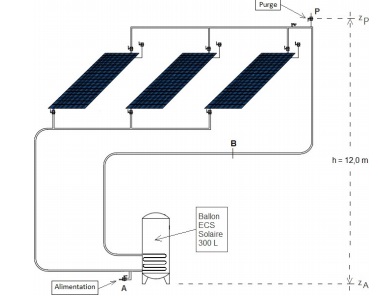Physique
chimie, Hotel de ville, BTS Fluides, énergies, domotique 2019.
En
poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation
de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres
d’intérêts.
|
|
......
.....
|
L’étude porte sur l’Hôtel de Ville d’une
commune du sud de la France.
Le bâtiment se situe directement en front de mer. Il comporte divers
locaux : bureaux,
accueil, sanitaires et vestiaires, salle du conseil municipal, diverses
salles de réunion et
d’archives, ainsi qu’un poste de la police municipale.
La chaufferie et l’ensemble des systèmes assurant le confort du
bâtiment se situent au rez-de-chaussée.
A. Pompe à chaleur.
L’objectif de cette
partie est de déterminer l’efficacité théorique de la pompe à
chaleur.
Le chauffage du bâtiment est assuré par une pompe à chaleur Air/Eau de
marque CIAT.
Le fluide frigorigène utilisé dans la pompe à chaleur est le R410A.
I. Cycle de la pompe à chaleur.
Le cycle idéal décrit par le fluide est représenté sur le
diagramme enthalpique
ci-dessous :
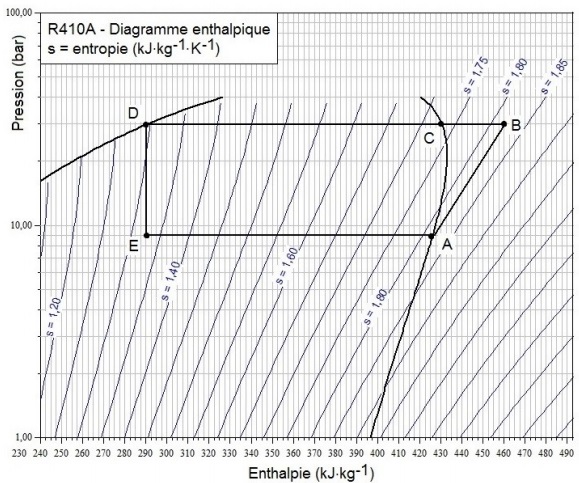
1. Indiquer la
nature des différentes transformations AB, BC, CD, DE et EA
(compression ;
détente ; refroidissement ; vaporisation ; liquéfaction) en précisant
leurs caractéristiques
(isobare ; isotherme ; isentropique ; isenthalpique).
AB : compression isentrope.
BC : refroidissement isobare.
CD : liquéfaction isobare et isotherme.
DE : détente isenthalpe.
EA : vaporisation isobare et isotherme.
2. À l’aide du diagramme
déterminer les valeurs des enthalpies massiques hA,
hB, hC, hD et hE aux points
A, B, C, D et E.
hA = 425 kJ kg-1 ; hB = 460 kJ kg-1 ; hC = 430 kJ kg-1 ; hD =hE= 290 kJ kg-1 .
3. Montrer, en
expliquant la démarche, que le travail massique w reçu par le fluide au
niveau du compresseur est égal à 35 kJ·kg-1
.
La compression est isentrope réversible, donc QAB = 0.
Pour un fluide en écoulement permanent, le premier principe de la thermodynamique donne : w +QAB = hB-hA.
w = 460 -425 = 35 kJ kg-1.
II.
Efficacité de la pompe à chaleur.
On donne les valeurs des échanges énergétiques suivants :
- chaleur massique reçue par le fluide au condenseur : qc =
- 170 kJ·kg-1
- chaleur massique reçue par le fluide à l’évaporateur : qe
= 135 kJ·kg-1
1. L’efficacité e
est la valeur absolue du rapport de la quantité de chaleur fournie par le
fluide
par le travail fourni par le compresseur.
Donner l’expression puis la valeur numérique de l’efficacité théorique
e de la pompe à
chaleur.
e = |Qc| / w = 170 / 35 = 4,9.
2. Donner une
interprétation énergétique de l’efficacité e.
L'efficacité d'une pompe à chaleur est le rapport entre la quantité de
chaleur restituée ( à un logement par exemple) et la quantité
d'électricité consommée pour produire cette chaleur.
|
...
|
|
B.
Échanges thermiques de l’enveloppe du bâtiment.
L’objectif de cette partie est d’estimer la valeur des pertes à travers
les parois du
bâtiment.
I. Description des
trois modes de transfert thermique.
Citer et décrire les trois modes de transfert thermique.
La conduction : pas de mouvement apparent de matière ; transfert d'énergie par contact entre un corps chaud et un corps froid.
Au
sein du liquide, la température n'est pas identique en tous points : en
conséquence, l'eau la plus chaude ( au fond) a une masse volumique plus
faible que l'eau plus froide de surface. On observe des déplacements du
liquide ou courants de convexion.
-
rayonnement :
Une barre de fer chauffée émet d'abord un rayonnement IR, puis un
rayonnement rouge, puis un rayonnement contenant de plus en plus de
lumière blanche. Un corps chaufé émet un rayonnement sous forme ondes
électromagnétiques.
-
conduction : les
métaux sont de bons conducteurs de la chaleur. Chauffons l'extrémité
d'une barre de fer, la chaleur se propage dans toute la barre.
-
convection :
la masse volumique d'un fluide dépend de la tempèrature. Si la
température n'est pas uniforme, les courants de convection transfert de
la chaleur des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides.
II. Calcul du
flux thermique à travers la paroi.
1. Calculer la valeur de
la résistance thermique R pour la surface totale des parois verticales.
Données :
Épaisseur des parois verticales : e = 16 cm.
Surface totale des parois verticales : S = 1 056 m2.
Conductivité thermique des parois verticales : λ = 0,032 W·K-1·m-1
.
Résistances superficielles des parois verticales.
rsi = 0,13 m2 K W-1 ; rse =
0,040 m2 K W-1 ;
R = (e / l +rsi +rse) / S =(0,16 / 0,032 +0,13 +0,040) / 1056 =4,9 10-3 K W-1.
2. Pour estimer les
pertes, le maitre d’œuvre souhaite connaitre la valeur du flux
thermique
Φ en kW à travers la surface totale des parois verticales lorsque la
température extérieure
est de – 4,0 °C et la température intérieure est de + 20,0 °C.
F = Dq / R =(20 -(-4) / (4,9 10-3) = 4,9 103 W.
|
....
|
C. Adoucisseur d’eau.
L’objectif de cette partie est de déterminer la masse de chlorure
de sodium
nécessaire au traitement de l’eau.
Afin d’éviter les problèmes engendrés par une eau de dureté élevée, un
adoucisseur a été
prévu. Cet adoucisseur est un adoucisseur à résine échangeuse d’ions.
I. Principe de
fonctionnement de la résine échangeuse d’ions
1. Rédiger une note de
service à l'attention du maître d'œuvre pour expliquer les problèmes
engendrés par une eau trop dure et l'intérêt d'installer des
adoucisseurs d'eau pour cet hôtel
de ville.
Une eau trop dure entartre les canalisations; elle mousse mal d'où une surconsommation de produits de lavage.
L'entartrage des canalisations de l'eau sanitaire favorise le développement de la légionellose.
2. Citer les ions
responsables de la dureté d'une eau et expliquer le fonctionnement d’un
adoucisseur à résine échangeuse d'ions.
Ion calcium Ca2+ et ion magnésium Mg2+.
II. Étude
quantitative de l’adoucissement et de la régénération de la résine.
L’eau traitée a une dureté initiale THi égale à 25 °f à l’entrée
du circuit d’adoucissement et
une dureté finale THf égale à 10 °f à la sortie du circuit.
Le technicien souhaite déterminer la masse m de chlorure de sodium NaCl
nécessaire pour
régénérer la résine lorsqu’un volume V de 100 m3 d’eau a été
traité.
Sachant que la résine perd deux ions Na+ pour chaque ion Ca2+
ou Mg2+ capté, le technicien
commence par déterminer la quantité de matière totale d’ions Ca2+
et Mg2+ captés par la
résine lors du traitement du volume V d’eau.
1. Montrer qu’il
obtient qu’il obtient une quantité de matière totale d’ions Ca2+
et Mg2+ égale
à 150 mol.
TH = 10 ([Ca2+] +[Mg2+]) avec les concentrations en mmol / L.
Initialement : [Ca2+] +[Mg2+]=25/10=2,5 mmol / L ;
Finalement : [Ca2+] +[Mg2+]=10/10=1,0 mmol / L ;
Variation : 1,5 mmol / L.
Soit dans 100 m3 ( ou 105 L) : 1,5 105 mmol =150 mol.
2. Après avoir
présenté la démarche suivie par le technicien pour déterminer la masse
m de
chlorure de sodium nécessaire à l’opération de traitement de l’eau,
calculer cette masse.
On indiquera les différentes étapes du raisonnement en précisant les
données ou
connaissances à mobiliser.
Quantité de matière d'ion sodium : 300 mol.
Quantité de matière de chlorure de sodium : 300 mol.M(NaCl) = 23 +35,5 = 58,5 g / mol.
m = 300 x58,5 ~1,76 104 g = 17,6 kg.
|
D.
Panneaux solaires thermiques.
L’objectif de cette partie est de déterminer le rendement des
panneaux solaires.
L’eau chaude sanitaire du bâtiment est produite grâce à trois panneaux
solaires thermiques
de marque Unical modèle Titanium se trouvant sur le toit.
Les panneaux sont remplis avec de l’eau glycolée MPG30%.
L’eau glycolée des panneaux est réchauffée par le soleil. Elle passe
ensuite dans un ballon
se trouvant au rez-de-chaussée. Dans ce ballon, un échangeur permet de
transférer la
chaleur récupérée dans le circuit d’eau chaude sanitaire.
Le dénivelé h entre la purge du système et l’alimentation en eau est
égal à 12 m.
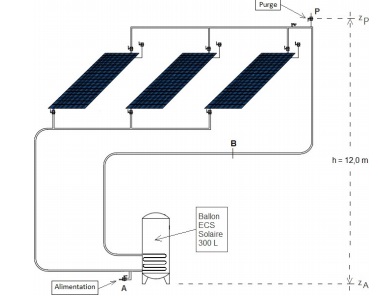
Données :
Pression atmosphérique : p atm = 1,00 bar.
Intensité de la pesanteur : g = 9,81 m·s-2.
Masse volumique : ρMPG30%
= 1,02.103 kg·m-3
I. Condition de
pression pour le remplissage du système à l’arrêt.
On applique une pression de 3,0 bar au point A du circuit
d’alimentation en eau lorsque le
système est à l’arrêt et complètement rempli d’eau glycolée.
Afin que le remplissage s’effectue convenablement, il faut que la
pression au point P soit
supérieure à la pression atmosphérique.
Montrer que cette condition est bien remplie.
Pression au point P : PA - ρMPG30% g h =3,0 105 -1,02 103 x9,81x12,0=1,8 105 Pa = 1,8 bar, valeur supérieure à la pression atmosphèrique.
II. Rendement des trois
panneaux solaires.
On considère une puissance solaire par unité de surface arrivant sur
les panneaux égale à
700 W·m-2 pendant une durée ∆t, P solaire.
La puissance Pr reçue par l’eau glycolée pendant cette même durée est
égale à 2,31 kW.
Calculer la valeur du rendement des panneaux solaires, η.
Surface des panneaux : 3 x 1,8 m2.
Puissance solaire reçue : 700 x3 x1,8 = 3,78 103 W = 3,78 kW.
Rendement : puissance reçue par l'eau / puissance solaire reçue = 2,31 / 3,78 ~0,61.
E. Nuisances sonores.
L’objectif de cette partie est de déterminer les mesures de
protection contre le bruit.
Le niveau sonore à proximité de la PAC en fonctionnement est de 90 dBA.
I. Expliquer l’intérêt de
la mesure du niveau sonore en dBA.
La sensibilité de l'oreille humaine dépend de la fréquence. Il faut
donc pondérer les intensités sonores par gamme de fréquences.
II. À partir de
l’extrait du code du travail, indiquer les mesures de prévention
qui doivent être mises en œuvre prioritairement afin de diminuer les
risques liés au bruit
pour un travailleur se trouvant à proximité de la PAC.
La valeur limite est 87 dBA pour une exposition prolongée.
90 dBA est supérieure à cette valeur limite.
Les personnes se trouvant à proximité de la PAC doivent porter un casque anti-bruit.
On peut également construire un écran acoustique autour de la PAC.
|
|
|