Physique
chimie,
technologie, SVT, Brevet Métropole 2020.
En
poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation
de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres
d’intérêts.
..
..
|
.
.
|
..
..
......
...
|
L'automobile contribue à l’émission de gaz
à effet de serre et de polluants
atmosphériques. Les constructeurs tentent de réduire son impact sur
l'environnement. La
voiture équipée d’une pile à hydrogène est une des alternatives à la
traditionnelle voiture à
essence.
La
voiture à hydrogène.
Une voiture à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. La «
pile à hydrogène »
incorporée est une pile à combustible. Celle-ci utilise, pour
fonctionner, un apport en
dihydrogène (le combustible) et en dioxygène (le comburant). Le
dihydrogène se combine
avec le dioxygène de l'air en produisant de l'eau. À cette
transformation est associée une
conversion d’énergie chimique en énergie thermique et énergie
électrique. Un moteur
électrique permet alors de propulser la voiture.
Cette technologie est parfaite pour réduire la pollution à l'échelle
locale. Par contre, elle ne
permet pas de réduire la pollution globale : le dihydrogène n'existe
pas sur Terre à l'état
naturel et plus de 90 % du dihydrogène produit sont issus de ressources
d'énergie fossile.
Question 1 (8 points)
1a- Extraire des
informations ci-dessus un argument montrant que l’utilisation d’une
voiture fonctionnant avec une « pile à hydrogène » peut présenter un
inconvénient d’un
point de vue environnemental.
90 % du dihydrogène produit sont issus de
ressources d'énergie fossile.
Le
vaporeformage du méthane CH4(g)
+ 2 H2O(g)
→ CO2(g)
+ 4 H2(g)
produit du dioxyde de carbone.
1b- De la même manière, montrer que
le fonctionnement d’une pile à hydrogène s’appuie
sur une transformation chimique.
Le dihydrogène
se combine
avec le dioxygène de l'air en produisant de l'eau.
1c- Toujours d’après ces
informations, associer sur votre copie chacun des trois numéros
du diagramme ci-dessous à une forme d’énergie choisie parmi les
suivantes : énergie
électrique, énergie cinétique, énergie thermique, énergie nucléaire,
énergie potentielle,
énergie chimique.
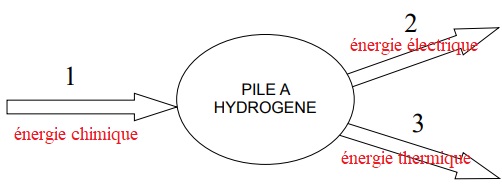
Question 2
(7 points).
On recueille un échantillon du liquide produit par la pile à
hydrogène. Proposer un
protocole expérimental, sous forme de phrases et de schémas, permettant
de mettre en
évidence la présence d’eau dans cet échantillon.
Dans une coupelle, placer quelques cristaux de sulfate de cuivre
anhydre.
A l'aide d'une pipette pasteur, ajouter quelques gouutes de liquide
produit par la pile à hydrogène.
En présence d'eau, les cristaux de sulfate de cuivre anhydre blancs,
deviennent bleus.
La majorité des automobiles fonctionne actuellement avec des moteurs à
essence ou avec
des moteurs Diesel. Plusieurs types de polluants sont émis par ces
véhicules : le dioxyde
de carbone, le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et des
hydrocarbures imbrûlés.
Les émissions de monoxyde de carbone d’un moteur à essence varient en
fonction de la
vitesse du véhicule.
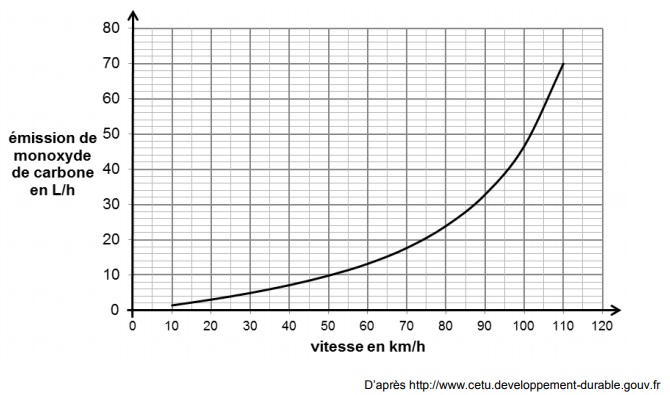
Question 3 (10
points)
3a- Les émissions de
monoxyde de carbone sont-elles proportionnelles à la vitesse du
véhicule ? Justifier.
Non, la courbe ci-dessus n'est pas une droite.
3b- À l’aide
de la courbe ci-dessus, on peut montrer que l’augmentation des
émissions en
monoxyde de carbone est de 3 L/h lorsque la vitesse passe de 40 à 50
km/h. Calculer la
valeur de l’augmentation des émissions lorsque la vitesse passe de 100
à 110 km/h.
Comparer ce résultat à la valeur de 3 L/h. Conclure.
Le graphe indique :70-47=23 L / h
Soit environ 8 fois plus que lorsque la vitesse passe de 40 à 50 km / h.
Il vaut mieux rouler à 100 km /h plutôt qu'à 110 km / h.
3c- Sur une
autoroute, un véhicule parcourt à vitesse constante 55 km en 30 min.
Évaluer
le volume de monoxyde de carbone émis durant ce trajet.
Le véhicule étudié respecte-t-il la norme Euro 5 qui limite la valeur
de l’émission de
monoxyde de carbone à 96,8 L/h lorsque le véhicule roule à cette
vitesse.
A 110 km /h, le véhicule produit 70 L de dioxyde de carbone par heure
soit 35 L en 30 minutes.
La norme Euro 5 est respectée car 70 < 96,8 L / h.
|
| .
. |
....
|
Technologie
Afin
de répondre aux engagements sur le réchauffement climatique,
des solutions naturelles et/ou techniques existent pour capter le
dioxyde de carbone (CO2) et dépolluer l’air.
L’étude propose d’analyser et d’améliorer le prototype d’un mur
végétal prévu à cet effet.
Ce type de système vise à être installé
là où l’implantation d’une solution naturelle n’est pas
envisageable.
Ce système est équipé de deux panneaux verticaux de mousse
internes du mur végétal. Il est autonome en eau et en énergie
électrique.
Question 1 (6
points).
Compléter les blocs internes du
mur végétal. Utiliser les termes suivants :
Ventilateurs (1), Motopompe (5), Panneau solaire (6), Batterie (7).
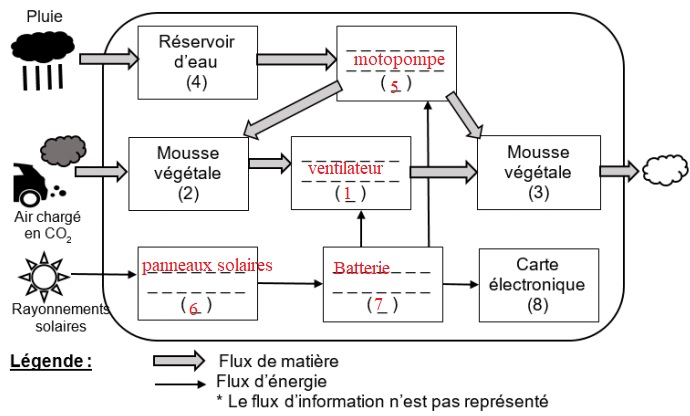
Les
normes du mobilier urbain, imposent au concepteur du mur végétal que le
châssis
respecte les conditions suivantes :
- résister au feu, être incombustible ;
- ne pas produire de fumée ou de gaz toxiques en cas d’incendie ;
- résister aux chocs.
Pour des exigences de développement durable, le matériau choisi
devra être recyclable.
Question 2 (7
points)
Désigner le matériau le mieux
adapté pour fabriquer le châssis au regard des exigences arrêtées,
argumenter la
réponse.
Le duralumin, contrairement au PVC et au bois de pin non traité :
est incombustible,
ne dégage pas de fumées toxiques,
possède une bonne résistance aux chocs,
a une bonne aptitude au recyclage.
Question 3 (8
points)
Afin de limiter la consommation en eau et éviter de remplir le
réservoir entre deux périodes
de pluie, le constructeur souhaite optimiser la gestion de l’arrosage
de la mousse. Compléter le diagramme
d'activité permettant une gestion optimisée de l’arrosage automatique
du mur végétal.
Utiliser les termes suivants :
- envoyer SMS ;
- jour ;
- arrêter motopompe.
- point de rosée non atteint ;
- réservoir vide ;
- démarrer motopompe ;
- mousse desséchée ;
- attendre 120 s ;
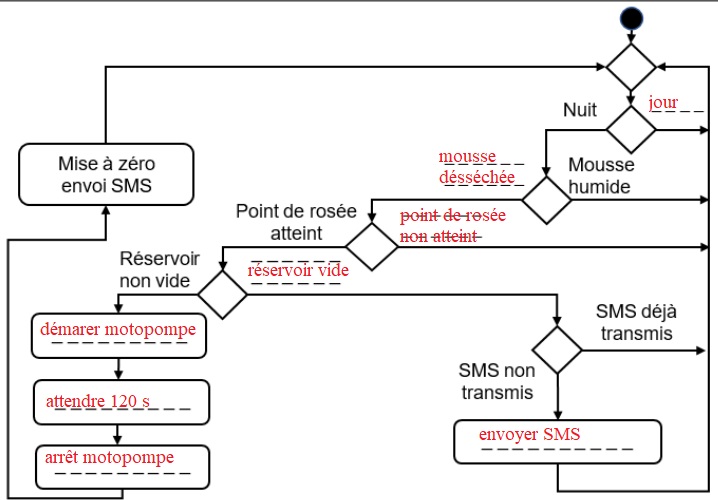
Afin d’assurer le suivi à distance du mur végétal, le constructeur a
intégré un système de
communication permettant d’envoyer un SMS au technicien de maintenance.
Pour permettre au technicien d’identifier le mur végétal concerné, le
SMS doit respecter le
protocole de communication suivant :
ALERTE MUR VÉGÉTAL : localisation - types d’alerte - date de l’alerte.
La localisation est définie par le numéro de département suivi du
numéro du mur,
exemple :
69-04 pour le mur n°4 du département du Rhône.
La date est donnée sous la forme : JJ/MM (jour/mois).
Les types d’alertes sont codés sur cinq lettres :
RENIB = réservoir d’eau niveau bas
HUMTF = humidité de mousse trop faible
VENHS = ventilateur hors service
POMHS = pompe hors Service.
Question 4 (4
points).
Dans le cas d’un défaut - réservoir d’eau niveau bas - survenu le
12 janvier sur le mur
N°15 situé en Gironde, compléter le SMS à envoyer.
Les différents départements sont repérés par les numéros suivants :
Seine = 75, Bouches du Rhône = 13, Ain = 01, Gironde = 33, Isère =
38, Nord = 59
ALERTE MUR VÉGÉTAL : 33-15 - RENIB -12/01.
|
Les
conséquences d'une espèces invasives sur la biodiversité.
1. Donner le nom de
l'espèce invasive et le nom de l'espèce menacée.
La tortue de Floride est l'espèce invasive. Elle menace la tortue
européenne, la cistude.
2. Citer les
éléments qui ont permis de classer une de ces deux espèces dans la
liste des espèces invasives en France.
L'absence de prédateur naturel permet à la tortue de Floride de se
reproduire et donc de proliférer en France.
La tortue de Floride est plus agressive.
La cistude voit son territoire et le nombre de ses proies se réduire.
3. Comparer les
habitudes de la cistude et de la tortue de Floride.
Les deux espèces occupent les mêmes zones humides et s'alimentent de la
même manière.
Par contre la tortue de Floride est sexuellement mature à 5 ans ( 10 à
15 ans pour la cistude) et peut pondre jusqu'à 20 oeufs ( contre une
dizaine pour la cistude).
4. Expliquer en
quoi l'introduction de la tortue de Floride représente une menace pour
les cistudes d'Europe.
Les deux espèces occupent les mêmes territoires et s'alimentent de la
même manière.
Mais la tortue de Floride se multiplie beaucoup plus rapidement (
maturité sexuelle à 5 ans et jusqu'à 20 oeufs pondus) que la cistude
d'Europe.
Or deux espèces ne peuvent pas occuper le même milieu de vie
durablement. La tortue de Floride est la mieux adaptée.
|
|