Exploration de la planète Mars.
La sonde spatiale Mars 2020, développée par la NASA, a été lancée le 30 juillet 2020. Après
un long voyage, elle est arrivée dans l’atmosphère de Mars le 18 février 2021 à 21 h 38.
Cette sonde a permis de déposer sur le sol martien un petit véhicule tout terrain, appelé
rover Perseverance.
L’entrée de la sonde dans l’atmosphère de Mars, jusqu’à l’atterrissage du rover, comporte
plusieurs phases décrites par le dessin suivant. Les vitesses indiquées sont celles de la
sonde.
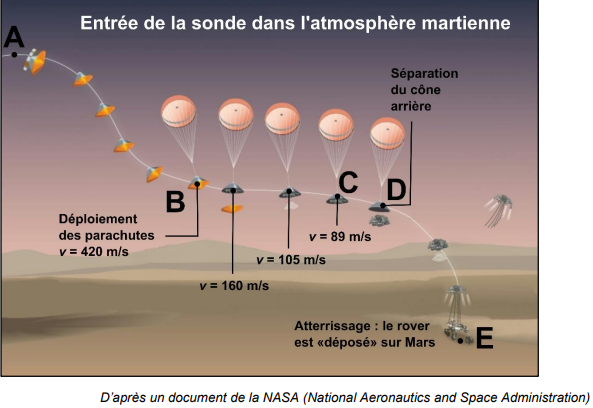 Question 1
Question 1 (2 points) : indiquer si le mouvement de la sonde entre les points B et C est
ralenti, accéléré ou uniforme. Justifier la réponse.
Entre les points B et C, la vitesse diminue de 420 m/s à 89 m /s. Le mouvement est donc ralenti.
Question 2 (3 points) : parmi les trois relations suivantes, recopier celle qui permet de
calculer l’énergie cinétique de la sonde. Préciser ce que représentent m et v.
Ec =
1/
2
× m × v
2 Vrai.
Ec =
1/
2
× m × v × 2
Ec =
1/
2
×
m
/v
2.
m : masse de la sonde en kg ; v : vitesse de la sonde en m / s.
Question 3 (2 points) : sans faire de calcul, indiquer comment évolue l’énergie cinétique
de la sonde du point B au point C. Justifier.
La masse est constante ; la vitesse diminue ; donc l'énergie cinétique diminue entre B et C.
Question 4 (2 points) : indiquer comment évolue l’énergie potentielle de la sonde du point
A au point B. Justifier.
Entre A et B, l'altitude diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue.
Cette énergie est prise nulle au sol.
Après l’atterrissage, le rover reste immobile pendant plusieurs jours, le temps de vérifier le
bon fonctionnement des instruments scientifiques embarqués.
Question 5 (2 points) : en négligeant l’action de l’atmosphère martienne, identifier les
actions mécaniques qui s’exercent sur le rover immobile.
Le rover est soumis à son poids, verticale, vers le bas, valeur mg et à l'action du sol, opposée au poids.
Question 6 (4 points) : schématiser le rover par un rectangle et représenter, au choix, la
force modélisant l’une des actions mécaniques par un segment fléché à l’échelle 1 cm pour
1000 N. Justifier la longueur du segment fléché.
Masse du rover : 1050 kg ; g = 3,72 N / kg sur mars.
Poids =mg = 1050 x3,72 =3 906 N. ( longueur de la flèche 3,9 cm).
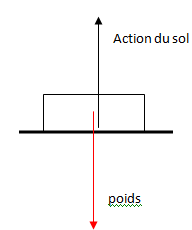
L’atmosphère de Mars est composée principalement de dioxyde de carbone CO
2 ; la vie
pour l’être humain y est donc impossible. Une des missions du rover est de fabriquer du
dioxygène O
2 à partir du dioxyde de carbone.
Question 7 (3 points) : donner le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde
de carbone et de dioxygène, et préciser leur nombre.
Dioxyde de carbone : 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone.
Dioxygène : 2 atomes d'oxygène.
La sonde et le rover peuvent communiquer avec la Terre à l’aide de signaux radio se
propageant à la vitesse de la lumière dans le vide. La phase d’atterrissage commence dès
l’entrée dans l’atmosphère de Mars au point A et s’achève au point E lorsque le rover touche
le sol. Cette phase dure environ sept minutes.
Question 8 (7 points) : en construisant un raisonnement prenant appui sur des calculs,
expliquer pourquoi si un événement inattendu se produit au cours de la phase d’atterrissage,
la Terre n’en sera pas informée à temps.
Distance Terre-Mars : 2,10 10
8 km.
Vitesse de la lumière dans le vide : v = 3,00 10
5 km /s.
Durée du trajet Mars-Terre : 2,10 10
8 / (3,00 10
5) =700 s ou 11 min 40 s.
Cette valeur étant supérieure à 7 min,
la Terre n’en sera pas informée à temps.