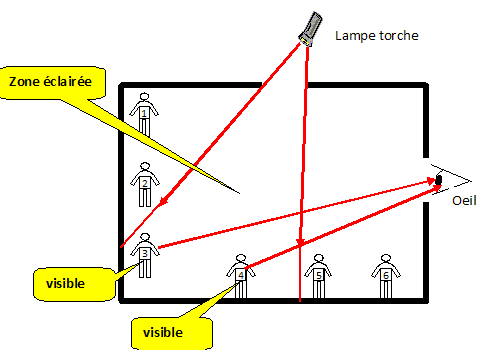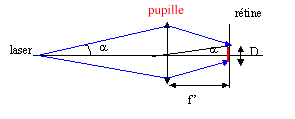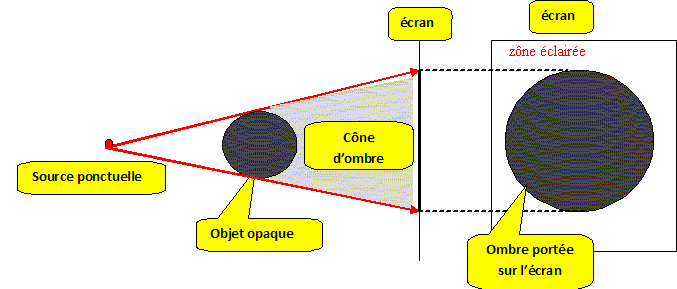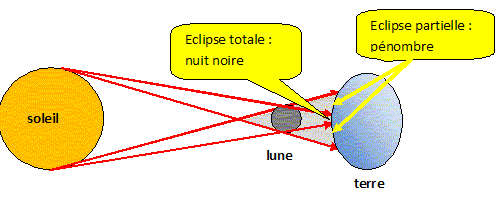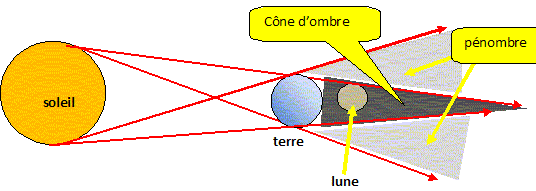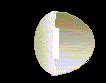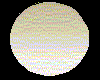|
Vision et lumière, ombres, éclipses, phases de la lune En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un corps incandescent ( porté à haute temprérature ) émet une lumière visible. la Lune, les planètes, les objets éclairés sont des objets diffusants, ou des sources secondaires de lumière : Ils émettent dans toutes les directions, la lumière qu'ils reçoivent. Pour voir un objet, il faut que l'oeil en reçoive de la lumière. Pour être visible, un objet doit : - être éclairé par une source de lumière. - cette lumière émise par l'objet doit rentrer dans l'oeil, le récepteur de lumière. Un corps opaque ne laisse pas passer la lumière. Compléter les phrases avec les verbes " absorber, diffuser, émettre". Un objet noir .......... toute la lumière qu'il reçoit. Un objet blanc ............ toute la lumière qu'il reçoit. Une ampoule électrique ......... de la lumière dite "blanche". Un objet noir absorbe toute la lumière qu'il reçoit. Un objet blanc diffuse toute la lumière qu'il reçoit. Une ampoule électrique émet de la lumière dite "blanche". Un segment de droite, avec une flèche,
représente un rayon lumineux La flèche indique le sens de propagation
de la lumière. Les objets 3 et 4 sont éclairés :
ils se comportent comme des sources secondaires et
émettent de la lumière qui peut
être reçue par l'oeil. Selon la puissance du laser et type de lumière émise, un laser peut représenter un danger pour les yeux et provoquer de graves brûlures de la rétine. Un faisceau laser est très directif et la puissance transportée par unité de surface est très grande. Le laser hélium-néon a été spécialement conçu pour les besoins de l'enseignement. Sa puissance est P = 0,5 mW. Un élève imagine un observateur très imprudent regardant dans l'axe du faisceau. Le faisceau entre entièrement dans la pupille. L'oeil est équivalent à une lentille mince convergente de distance focale OF' =f '= 15 mm selon le schéma ci-dessous :
Le diamètre D de la tache lumineuse sur la rétine, placée orthogonalement à l'axe optique de la lentille, dans le plan focal image est égale à : D= f ' 2a = 15*2 10-3 = 0,03 mm. surface de cette tâche : pr² =3,14*(1,5 10-5)²= 7,06 10-10 m². Eclairement énergétique reçu par cette tache. puissance reçue par unité de surface : 0,5 10-3/ 7,06 10-10 = 7 105 Wm-2= 7 102 kWm-2. Comparaison avec la valeur obtenue à celle de l'éclairement moyen du Soleil sur la Terre : 1 kW.m-2. 700 fois supérieur à l'éclairement moyen du soleil : donc risque de détérioration de la rétine.
Comment se propage la lumière ? Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage de façon rectiligne. Le trajet rectiligne de la lumière est modélisé par le rayon lumineux. Un segment de droite, avec une flèche, représente un rayon lumineux La flèche indique le sens de propagation de la lumière. Ombre propre. Ombre portée. Une source lumineuse ponctuelle et un objet opaque déterminent deux zones : une zone éclairée de laquelle l’observateur voit la source, une zone d’ombre (appelée cône d’ombre) de laquelle l’observateur ne voit pas la source. Une zone d'ombre est une zone non éclairée : elle est noire. L'ombre portée a la forme de l'objet.
Les différentes formes de la lune, éclairée par le soleil, observées depuis la terre se nomment les phases de la lune. Le cycle lunaire correspond à une rotation complète de la lune autour de la terre : il dure 29,5 jours. La lune est une source de
lumière secondaire : elle réfléchit
environ 7 % de la lumière qu'elle reçoit du
soleil.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||